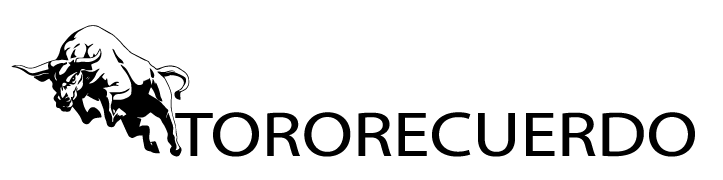Sevilla, jeudi 20 avril 2006, Pepin Liria, Luis Miguel Encabo et El Cid face à des Victorino.
Premier “no hay billettes” de la féria d’avril mais pour moi, et en dépit de l’affluence, un cartel qui ne sonne pas très sévillan. Des toros réputés durs mais dont le lot de Madrid en octobre m’a laissé le plus mauvais souvenir; de plus en plus fréquemment des lots sans force et, en tout état de cause, des faenas vaillantes plus qu’inspirées, les fauves, même faibles, ne laissant guère aux toreros le choix des chemins de traverse.
Les Victorino du jour ont été décevants, faibles pour la plupart, et quelques uns décastés, prenant la pique sans bravoure mais quelquefois avec une sauvagerie donnant le change ( 2ème et 4ème).
Les trois premiers combats ne laissent guère d’espérance en dépit des banderilles d’Encabo et de quelques muletazos de la gauche del Cid sur le troisième, trois belles séries avant que le toro ne s’éteigne.
Et puis, vient le mystère de la course, un Pepin Léria qui traverse le ruedo avec décision, la cape en mains, sous les applaudissements du public, et qui s’agenouille devant le toril, la cape déployée autour de lui, attendant la sortie d’un fauve dont il ne sait rien, s’en remettant au destin pour, à sa sortie, le citer à genoux et le surprendre de deux largas afaroladas de rodillas. Cette attente de la bête, la porte du toril ouverte sur le sort, est interminable, tendue et vertigineuse comme le cri d’un géant wagnérien. Soudain, le toro sort. La juridiction entre l’homme et la bête le long d’un revers de cape dans les airs est pleine de sauvagerie, le toro frôlant Léria qui se relève et l’appelle à nouveau pour lui servir trois véroniques dominatrices, puis deux encore devant une arène, toute de rugissements face à cette échappée violente.
Etait-ce le désir de rattraper une corrida jusqu’alors ennuyeuse, était-ce l’homme ou la bête, était-ce le hasard des choses ou ce qu’il donne quand on le sollicite, ce quart d’heure de combat sera de feu. Le toro (“Morisco”) se bat à la pique en deux rencontres de châtiment et poursuit avec entrain les banderilleros. Pepin LERIA l’offre à Emilio Munoz, assis dans les gradas, dans une scène où tout est étrange : cette place-là, si haut dans l’arène, pour un torero de la classe d’Emilio, voir ce combattant offrir la mort de son toro à celui qui fut un artiste si délicat, et ce torero croire en ce toro-là – car l’on offre généralement un espoir de triomphe, qu’en l’espèce rien d’autre que la volonté du matador n’annonçait.
Et triomphe il y a, fait d’une faena âpre où le torero, dominateur de la première à la dernière passe, parviendra à embraquer le fauve dans des passes d’abord heurtées, puis plus longues, jusqu’à ce que la bête, soumise par tant d’efforts, se rende, donnant alors, dans les deux séries finales, son fond de caste, désormais asséché de tout genio. Une oreille unanimement réclamée pour ce trasteo valiente, cette ancienne tauromachie faite de savoir et de courage.
Le 6ème suscitera les protestations du public dès son entrée en piste, sans que la raideur de son train arrière ou un certain fléchissement des membres ne soient plus marqués que ceux des exemplaires précédents. Mais c’est Le Cid, de Séville, qui torée et sans doute la Maestranza se lasse-t-elle des Victorino.
Le Pereda de remplacement sera un régal de bravoure, de noblesse et de caste. Le Cid lui sert une faena entièrement gauchère. Séville savoure le beau geste et le temple. Une certaine sécheresse me retient cependant – une allonge de bras très belle et des passes très lentes, mais un poignet qui n’est pas à la hauteur du bras, d’où un manque de lié (une passe lente, puis deux, trois pas en arrière ou de replacement, puis une autre passe, lente, très lente) et presque une absence de poésie qu’on était fondé à attendre, de ce torero-là avec ce toro-ci. Une oreille. De celles qui sont d’abord moins que deux.
A leur sortie, les trois hommes seront applaudis.
Séville restant toujours Séville, il faut cependant dire un mot de la bronca. Oh, non, pas de celles où la plaza s’étourdit de sa propre rage, généralement réservée à ses toreros, ceux de Séville qu’elle chérit toujours, sermonne quelquefois et déshérite avec violence – mais alors le temps d’une faena, ou, au pire, d’un après-midi- parce que, ce jour, le torero apathique ou couard lui fait honte ( “Le sang de mon sang! Un tel spectacle! Ne peut-il donc être digne de ses anciens, nous qui l’avons tant choyé, qu’aurions donc nous dû faire si tout cela n’a pas suffi? Ah, non, quel sort cruel! Fuera! Fuera! Je ne te connais plus, je ne te reconnais plus. Tu me fais trop de mal. Tu es la honte de la famille! Va, va et que je ne te revoie plus”) avant de se raviser dès le toro suivant parce qu’un fils est un fils, et que celui-là est d’un bon sang, que l’on est fier de le voir resplendissant dans son habit de lumière et que l’on sait de quoi il est capable, les jours avec.
Non, pas ce type de bronca mais une récrimination incertaine, presque timide, à peine osée parce que celui qui en fait l’objet n’est pas torero, en tout cas il n’affronte pas les toros à pied. Celui-là est un sage et un savant. C’est le maestro de la banda de musica de l’arène et il est si savant et normalement si sage qu’il serait inconvenant de le rabrouer, comme on peut le faire d’un mauvais fils. Mais aujourd’hui on le siffle quand il joue parce qu’il n’a pas joué précédemment et que, sur ce toro-là, il a joué trop tard, quand tout était accompli.
Dans toutes les arènes du monde- sauf Madrid où l’on ne joue jamais durant le combat-, la banda de musica est appelée à accompagner la faena d’un pasodoble lorsque la présidence de la course estime que le travail du torero le mérite et qu’elle en donne l’ordre à son chef. Le maestro alors se lève et la fanfare retentit avec plus ou moins de bonheur, étant plus ou moins en harmonie avec le jeu de l’homme et de la bête. Quelquefois, le choix du paso qui porte presque toujours le nom d’une figura du toreo (Belmonte, Manolète, El Cordobès, Paco Ojeda) trace une généalogie, illustre une parenté, distinguant une manière de toréer, récompensant le torero d’un parrainage glorieux. Oui, un paso peut adouber un torero, surtout à Séville.
Mais ici, on ne donne pas d’ordre au maestro de la banda de musica, Don Tristan, Tristan Tejera. C’est lui, et lui seul, qui décide de la musique et de son moment. Nul ne conteste son titre à le faire tant il est devenu, du son des cuivres qu’il dirige, le meilleur chroniqueur de la course, jouant joyeux, épique ou grave selon ce que les circonstances lui dictent, cessant de jouer lorsque les choses se dégradent, soulignant les faits d’arme, l’inspiration ou el arte du toreo mais préférant toujours le silence à une musique qui ne serait que d’encouragement ou d’agrément. Don Tristan a ses pasos préférés, enregistre des disques, ne parle jamais et joue rarement.
Il a la retenue et l’autorité d’un oracle. Son silence nous dessille de l’illusion, de la tricherie ou de la facilité et son office nous dit la rareté du duende. Il a aussi ses fantaisies et joue quand ça lui chante, à tout moment de la lidia, sans se borner, comme partout ailleurs, à n’accompagner que le troisième tiers- celui de la faena. Un quite de cape, une demi-véronique d’anthologie, une paire de banderilles valeureuse, un toro qui charge avec alegria pour sa troisième pique, tout lui fait profit dès lors que la toreria souffle et que le moment est exceptionnel. Etant très exigeant, ce moment demeure rare à ses yeux et donc à nos oreilles.
Aujourd’hui, le maestro n’a pas joué lors de la faena del Cid au troisième à la grande déception du public- et l’on entendait, de-ci de-là quelques fort irrévérencieux “ musica!” comme si la foule pouvait, ici, s’autoriser une telle injonction ; il n’a joué qu’en extrême fin de faena pour Pepin Leria sous les sifflets du public qui lui reprochait d’avoir tant tardé à le faire; a semblé s’irriter, enfin, de la règle qui impose de jouer quand le torero plante lui-même les banderilles en servant un pasodoble suave “ Por sevillanas” tout à fait mal adapté aux rencontres entre Encabo et son faible cinquième.
Pourtant…Comment mieux dire qu’un combat avec un toro décasté ne suscite aucune forme de plaisir qu’en lui opposant, d’un contre pied ironique, une jolie sévillanne? Que le Cid sur son premier avait incompréhensiblement insisté sur la difficile corne droite qui lui imposait de rompre après chaque passe alors que son toro passait bien à gauche, qu’en faisant le silence ? Enfin, que l’on ne joue pas un pasodoble quand le torero se joue la vie, seule l’issue du combat pouvant justifier de fêter sa victoire?
Olè, y olé. Viva el maestro Tristan!
Sevilla, vendredi 21 avril 2006, toros de Zalduendo pour Enrique Ponce, Morante de la Puebla et Miguel Angel Perera
Grande expectation, le vénérable numéro un, de Valencia, l’attendu Morante de Séville et le jeune Miguel Angel si splendide à Madrid en octobre.
Ponce a été énorme et Séville, ordinairement si réticente à se rendre à sa tauromachie technique, à ses gestes d’une froide précision chirurgicale et moi à sa muleta large comme un drap de lit et- pourquoi ne pas l’avouer?- à sa mine de programmeur en informatique, sommes à genoux, une porte des Princes ouverte dans nos coeurs, seule la malchance à l’épée l’ayant privé d’une sortie sur le Guadalquivir.
Il y eut d’abord ce premier toro d’une violence inouïe, qui ruait, débordant d’une caste sauvage indomptée, les pattes en avant dans le capote de Ponce, a désarmé un péon d’une cornada criminelle qui a cisaillé l’air comme un cimeterre ottoman, a ensuite désarmé Ponce lui-même, menaçant, la tête haute, celle du cheval à la pique et qui paraissait ne rien craindre de l’un puis de l’autre châtiments, des piques puissantes et sans retenue dans lesquelles le picador mettait toute cette énergie que l’on puise à l’odeur du danger quand il ne fait place qu’à l’effroi d’un instant qui peut être le dernier, le cheval cabré en dépit de son caparaçon, Saint Georges terrassant le dragon, non loin de deux capes roses sur le sable, traces de combattants défaits, et des visages du péonage, les traits déformés par la peur, sous un ciel gris et menaçant.
Une troisième pique s’impose qu’autorise la présidence. Le toro est amené face au cheval et quand le piquero lève le bras pour le citer à nouveau, Séville, soudain, proteste et s’y oppose. Comme une bande de gangsters qui exige de l’inconnu souhaitant la rejoindre un fait d’arme exceptionnel lui valant droit d’entrée. Quelle réaction curieuse pour un si fin public…
Ce toro est un tueur et Ponce n’a plus rien à prouver. “Eh bien voyons!” crie la foule à ce numéro un qui ne fut jamais le sien. Ponce se plie sans résister à cette provocation et sollicite de la présidence le changement de tiers. Au palco, le mouchoir blanc tombe sur le velours grenat : le sort en est jeté, il n’y aura plus de pique, c’est à toi désormais torero de faire ton affaire de ce monstre. L’élégante Maestranza l’exige, comme une châtelaine en son donjon rêve d’éprouver elle-même la réputation du valeureux guerrier.
Aux banderilles, le public est suspendu à la sauvagerie de la charge, n’étant soulagé que lorsque les peones, après avoir planté les bâtons tant bien que mal, parviennent à la talanquera.
Ponce prend la muleta et l’épée, va saluer la présidence et commence son combat par des doblones dont le geste sûr et l’efficacité font rugir la plaza. Passes de châtiment dominatrices, jeu de jambes avisé, muleta de combattant, puis le fauve se rend, sinon sur la droite, du moins sur la gauche, une, deux, trois séries de naturelles, ponctuées, chaque fois, de pechos profonds qui libèrent la charge de la bête et l’émotion des spectateurs, lesquels se frottent les yeux de voir ce torero jouer maintenant avec un toro à sa main, comme ces magiciens qui, d’un mouvement du poignet dans un mouchoir blanc, font d’un lapin une colombe.
Malchance à l’épée, non concluante, qui oblige au descabello, et un ne suffira pas. Pas d’oreille mais qu’importe. Comme dans les westerns, lorsque la bande a commis l’erreur de fixer à l’inconnu un droit d’entrée trop élevé, celui qui est parvenu à en payer le prix rafle la mise. D’une faena Ponce est devenu chef et on ne se souvient plus qu’il ait eu un prédécesseur. Vuelta triomphale et Séville, à son tour, se rend, dans l’éblouissement et, désormais, sans rancune.
Mais Ponce ne devait pas en rester là et son second toro (le quatrième de la course) devait lui octroyer le triomphe. Séville y était enfin prête, en dépit de l’amertume provoquée par la prestation précédente d’un Morante en méforme.
Il y eut d’abord un geste qui leva les ultimes préventions, lorsque le toro bouscula Ponce qui trébucha dans les pattes du fauve et ne dut son salut qu’à un quite de Morante. Enrique se relève, court rejoindre sa bête, puis se ravise, fait quelques pas en arrière pour donner un fuerte abrazo à Morante. Ayant publiquement manifesté sa reconnaissance à un sévillan qui lui avait sauvé la vie, Ponce est désormais de la famille.
Il y eut ensuite ces passes de quite por delantadas (passes de véroniques les pieds joints, la cape au plus près du corps) et une demi d’anthologie, la cape comme ces noeuds de rubans un peu haut sur la hanche des saintes de Zurbaran, qui fit se lever la Maestranza.
Puis un tercio brillantissime de banderilles où le public fit saluer, par la ferveur de ses applaudissements, montera en mains, non seulement les frères Tejero -magnifiques banderilleros– mais aussi Mariano de la Vina, péon de brega – fonction technique et subalterne, qui consiste à placer le toro en quelques passes de cape face au banderillero-, lequel dut également se découvrir sous l’injonction de la foule qui criait, la main en l’air, trois doigts levés : “tres, los tres” (“les trois, les trois ensemble”). La musique du Maestro Tristan retentit alors pour souligner la rareté de l’instant. Avec sa part d’ambiguïté, nul ne sachant s’il s’agissait de féliciter les peones ou de rendre hommage à la vista et à la générosité de cette plaza qui sait tout voir et faire un triomphe même aux modestes, même à un peon de brega. J’ai pour ma part entendu dans ce paso pour banderilleros comme une réponse à l’inquiétude grave d’une Séville veuve du succès de ses toreros “ Dis-moi miroir, suis-je toujours la plus belle….”
Ponce avait à peine dessiné quatre doblones, le genou plié, avec changement de mains à la clef que le maestro Tristan Tejera reprenait la baguette, plus rien ne devant alors arrêter la musique de toute la faena. Amples séries à droite, puis à gauche, pechos profonds, doblones encore quand il le faut, et le tout dans le sitio, lié à la perfection, avec rythme, temple, puis douceur, dessinant des lignes parfaites, que d’étonnants changements de mains prolongent à l’infini. Le toro semble s’enivrer de tant de magie autour de lui. Quelque fois, la beauté de cette tauromachie est si évidente que l’on n’en comprend plus les linéaments secrets ; on se lève, on applaudit debout ; on ne sait pas si cela continue ou s’achève. On est comme la bête, aux pieds du torero.
Puis, Ponce droit comme un i mais attentif et plein de sollicitude à l’égard de son partenaire qui s’épuise en fin de faena, replie la muleta sous le bras, se positionne face au toro, déploie soudain le tissu et dessine une naturelle de face. Le toro suit l’étoffe qu’un poignet éloigne au milieu des “olés” de la foule. Le torero replie encore la muleta, fait quelques pas sur une ligne imaginaire qui encerclerait la bête, laquelle le suit du regard et, comme lui, fait quelques pas. Elle se trouve maintenant face à l’homme. La muleta se déploie à nouveau et le toro passe encore. Cette scène d’un tissu qui se dérobe, d’un fauve encore enivré de combat mais que son partenaire économise pour le mener au plus loin des possibles, ce tissu qui se déploie comme une ultime caresse toujours recommencée, semble ne pas devoir cesser. Séville est sidérée de plaisir.
Une mauvaise épée comme quand on ne veut pas en finir. Et les deux vueltas al ruedo face à une foule enthousiaste ne peuvent pas dire l’intensité de cette faena, ni l’intimité que ce torero a noué avec chacun d’entre nous, par tant de dominio, de douceur et de grâce, au centre de cette arène, avec son toro et son chiffon.
Miguel Angel Perera dont le premier toro ne permettait que peu pouvait difficilement, après Ponce, réveiller la Maestranza de son songe. On ne reconnaissait pas le vaillant torero de Madrid en octobre et il s’est mis en tête d’ojediser à Séville, dans l’indifférence générale, passant, sans doute, à côté du meilleur toro de l’après-midi.
Morante est sorti, impérial, sous les sifflets, la bronca et les coussins, sans presser le pas, sûr de son art, et de la versatilité des foules.
Sevilla, samedi 22 avril 2006, Jandilla et autres ( Zalduendo et La Dehesilla) pour Cesar Rincon, Sébastien Castella et José Marie Manzanarés
Un toro sorti par erreur à la place d’un autre et que la cuadrilla de Rincon refuse de toréer, qui erre seul dans le ruedo durant cinq minutes avant d’être rentré au toril….et de ressortir en cinquième position pour Castella. Un autre qui, fonçant sur le premier burladero venu, face au toril, s’assomme et meurt en piste. Voilà qui commençait mal.
Mais Castella devait, dans un magnifique costume nazaréen et or -très semaine sainte, très Grand Poder-, illuminer cette journée.
Grand capéador tant à la réception qu’au quite, calme et sûr de lui, il étonne dans un quite por tafalleras aérien et suave qui fait murmurer la plaza de plaisir.
Le très noble zalduendo allait servir à la muleta avec une alegria que Sébastien a su mettre à profit. Droit au centre du ruedo – dont il ne bougera plus d’un pouce durant toute la faena-, Castella cite le toro de loin pour une pasa cambiada dans laquelle, de profil, la muleta dans le dos, il fait passer le tissu d’un côté à un autre au moment où la bête s’approche faisant dévier soudain sa charge, lui demeurant immobile, comme au centre de toute chose. Les pieds toujours joints, il enchaînera, impavide, statuaires, et autres cambiadas de espalda. Ces quatre ou cinq passes d’entame de faena déclenchent la musique, laquelle ne s’arrêtera plus.
Très vertical, avec un aguante incroyable, il tirera ensuite derechazos templés et naturelles profondes, la main fort basse, stoïque face à la tourmente du fauve ivre de passes. Le tout est aéré, d’un rythme parfait, facile. On entend quelquefois une voix fluette sortir de ces arabesques rappelant le jeune âge du maestro au visage d’enfant qui commande à la bête.
Il y a quelque chose d’un peu surnaturel au centre de l’arène, une volonté de fer et ce poignet d’adolescent, une innocente candeur et un geste sûr, ce danger qui menace et cette irradiante indifférence des martyrs possédés.
Cette verticalité et cette grâce immatérielle du Français au centre du ruedo, c’est le giraldillo descendu dans l’arène. Cet ange de bronze que, lors de la Reconquista, les rois d’Espagne ont posé avec délicatesse sur la Giralda, ce minaret musulman qu’ils entendaient préserver en faisant leur par une discrète empreinte catholique.
Aujourd’hui, Castella est cet ange d’une reconquête qui sait préserver l’essentiel, comme le plus bel hommage rendu à Séville par un torero du for, quelques oeillets rouge sang jetés dans le ruedo par une main d’enfant reconnaissant.
Le toro, le corps traversé d’une épée fulminante, résistera à la mort, luttant pendant d’interminables minutes de bravoure, comme un combattant qui refuse de se rendre, allant à petits pas au centre de l’arène puis vers les barrières, contre lesquelles il s’appuie, en un ultime secours. Cette agonie que rien ne doit interrompre est atroce et souveraine. Ici, on applaudit cette bête secouée par la mort, comme la foule, réunie dans les arènes les jours de deuil, applaudit au passage du cercueil du torero. Avec gravité, angoisse et admiration. Et en se souvenant du Christ du Grand Poder.
Deux oreilles, dans l’enthousiasme.
Le cinquième toro, très réservé et manso fuit vers les tablas. Le petit Prince n’aura pas droit à sa porte.
Rincon, face à un premier manso con genio ne fera rien, pas davantage à son second.
Sevilla, enfin, aura fait la dernière faena de Manzanarès hijo devant le meilleur toro de l’après-midi (Zalduendo), noble et encasté. Le public qui voit le toro que l’autre ne devine pas l’encourage de “Bien” qui le mettent en confiance. D’abord débordé des deux côtés, le fils dessine peu à peu de jolies passes mais clairsemées -trois pas en arrière chaque fois- avant de les lier davantage. Musique. Un pecho sous lequel le toro s’enroule autour du mannequin fait rugir l’arène. Etant partie de rien, constamment parallèle et du pico, la faena est allée a mas, puisque la plaza le voulait ainsi. Le torero est passé à côté de la faena qu’autorisait le fauve mais quelques beaux gestes épars lui vaudront une oreille que Séville est heureuse de s’offrir à elle-même.
Très applaudi à la sortie, Sébastien refusera qu’on le porte a hombros (sur les épaules). Séville apprécie cette juste mesure des choses.
Sevilla, dimanche 23 avril 2006, Jesulin de Ubrique, El Fandi et Serafin Marin devant des boeufs, meubles bas de bibliothèque del Torreon (ganaderia rachetée par Cesar Rincon).
Ennui le plus total sous des trombes d’eau, puis, à partir du cinquième, une punition de grêle. Fandi refuse que l’on arrête la course face au chef de lidia désappointé. Je quitte l’arène sous les grêlons, ratant une faena épique et suicidaire en souvenir d’un tel déchaînement dont je me suis épargné en allant m’abriter après le quatrième. Corrida suspendue après le cinquième.
Sevilla, lundi 24 avril 2006, Torrestrella- Finito de Cordoba, Morante de la Puebla, Salavador Vega
Toros lourds et sans caste- les trois premiers faisaient plus de 600 kgs, 620 le second…
Finito s’est, sur ses deux adversaires, fait enfermer aux tablas comme un jeune premier. Rien à la muleta.
Morante a suscité une bronca majuscule à son premier, se réservant sans doute pour le cinquième où on lui avait déjà tout pardonné. Quelques belles véroniques – mais un jour d’application sans grâce- et une très belle demie -mais à cent coudées du chef d’oeuvre de Ponce l’autre jour- ont mis l’eau à la bouche de ceux qui refusent de se résigner à mourir de soif. Les “Olés” furent puissants de toute l’attente contenue des cinq faenas précédentes de Morante sans rien. A la muleta, l’arène a retenu son souffle à chaque début de série, soupiré de déception dès la deuxième passe, croyant tout de même au miracle qui se faisait attendre. Bon, Morante avait fait un effort, respectable mais vain : division d’opinion à la fin de la tarde et pour lui de la féria- il s’agissait de son dernier contrat. Seule sa sortie sera torera, toujours ce pas lent face à l’adversité.
Salavador Vega, de Malaga, aura donné le meilleur par ses véroniques de réception, dominatrices, templées et en gagnant du terrain à chaque passe et par chicuelinas sur le toro de Morante, serrées et très basses, l’étoffe repliée au niveau des chevilles, mais un peu affectées. Il aura cependant commis l’erreur d’aller encore au quite sur le second toro de Morante, dont les trois véroniques et la demie avaient laissé espérer le meilleur, suscitant la sourde réprobation du conclave à le voir prendre ainsi le risque de gâcher l’animal de l’artiste, comme s’il avait volé son goûter à son camarade. Et, desgracia, ce quite sera nul. Quelques sifflets épars.
Erreur de jeunesse.
Séville qui s’est sans doute trouvée ridicule d’ainsi réagir surtout à l’égard d’un andalou, et après la démonstration ratée de Morante sur ce toro, fera savoir le lendemain, par presse interposée et avec une fausse innocence, que le jeune torero, plein d’entrain, avait souhaité aller au quite chaque fois que son tour lui revenait. Livrer cette explication d’évidence, c’était souligner davantage encore la nécessité qu’il en fallût une, comme si la chose décidément n’allait pas de soi quand il s’agit de faire un quite sur un toro de Morante qui peut servir. Et chacun de se convaincre que s’il s’agissait d’une pétition de principe du jeune torero de Malaga, alors aucun blasphème n’était à lui reprocher, nul n’ayant manqué de respect à l’icône locale, fut-elle infertile en ces temps de vaches maigres…
Ah, Sevilla!