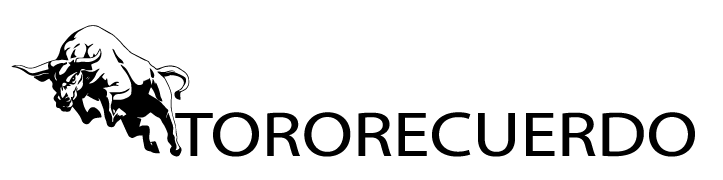Arles, la ville dont le Prince est un torero, savait que Juan Bautista avait fait les choses en grand. Les rues bruissaient de nervosité et de ferveur ; on processionnait déjà rue de la Calade, blottis les uns contre les autres ; le rond-point des arènes était noir de monde et ça bouchonnait grave côté Luppé trois quarts d’heure avant le début du spectacle. Une telle affluence était inédite. Pour rien au monde, Arles, la Crau et la Camargue n’auraient raté les adieux du torero à sa ville.
Et toute la ville était là, une foule ravie et surtout rajeunie. Ce jour, on venait aux arènes en couple, entre amis, en famille mais surtout en bande. Des jeunes comme on n’en voit plus dans les arènes, des gitans, des rebeus. Dieu que ça fait du bien de s’apercevoir qu’un torero peut encore attirer les foules, que l’événement d’une retirada fait sens, que c’est le moment où jamais où il faut rameuter tout le monde, les cousins et les potes, même ceux qui ne sont pas aficionados, ou qui ne le sont que d’occasion. Ils étaient tous là, Barriol, Le Trébon, Trinquetaille, Monplaisir, Griffeuille, au milieu des gilets jaunes, des ex-cocos, des émissaires chics de Patrick de Carolis et de quelques nîmois qui n’en revenaient pas, tant ils se sont accoutumés à ne plus vivre les uns avec les autres.
Ce jour, le Prince a fait de sa ville un village d’aficion et a ouvert ses arènes au monde.
Des arènes de « no hay billettes », décorées avec goût, un ruedo superbe en fleurs de tournesol en hommage à Van Gogh, une banda Chicuelo II au meilleur de sa forme- comme souvent à Arles- accompagnée d’un chœur et d’une mezzo un peu envahissante mais au timbre profond, des habits goyesques d’une grande beauté, surtout celui de Juan Bautista, enveloppé d’une cape de velours vert foncé, costume vert, ramages bruns aux reflets auburn.
Pour sûr, les toros n’étaient pas très en pointes, des toros à tête commode de festival entre amis. Et la présidente, en costume d’arlésienne, a bien failli nous gâcher la fête, par une distribution incontrôlée de mouchoirs de toutes les couleurs, allant jusqu’à accorder deux vueltas (au bon La Quinta sorti en 4ème pour Juan Bautista, celle-là n’était que ridicule, et au Juan Pedro d’une pique et demie, atrocement soso, sorti en 5ème pour Ponce – et celle-ci, vraiment affligeante, a été protestée par une bronca d‘anthologie à l’heure de l’hommage à sa dépouille).
Ponce a fait du Ponce, parallèle et toréant du pico, mais donnant le change par cette élégante raideur et ce faux relâchement à quoi ils nous a accoutumés depuis 30 ans. Ses très douces véroniques de réception a camera lenta devant son Cuvillo, un peu faible mais plein d’allant et de bon moral, sont à retenir, comme sa main gauche, surtout après changement de main, sur cet adversaire intéressant de jeu, très noble et qui se reprend en cours de faena privant le maître de ses tentatives répétées de génuflexions poncinistas, toutes avortées (deux oreilles après bajonazo…). L’Adolfo Martin nous offrira un joli tercio de piques (le toro saute littéralement sur la tête du cheval à la première, la seule qui sera bien exécutée et vient très fort sur les deux suivantes mais sans pousser) puis se révèlera tardo à la faena. Enrique, précautionneux, s’applique, insiste et tire deux séries au final de ce toro de demi-charge qui arrivera à la mort gueule fermée (silencio). Le début de faena sur le Juan Pedro, conduit au centre par passes par le bas et trincherillas, le torero très vertical les jambes croisées en entrechats de petit rat de l’opéra, sera brillant, comme les séries à droite qui suivent, main basse, geste lent, relâchement de la ceinture -après le passage… Cela ne suffira pas, alors Enrique exige la musique et la banda se met à jouer. A compter de cet instant, la faena baisse beaucoup de ton devant ce toro sans présence. La foule sans s’en aviser applaudit alors les intentions et l’allure du torero plus que la passe. Poncinas comme s’il en pleuvait. Cette œuvre inachevée et vilainement ordinaire en sa deuxième partie vaudra au matador les trophées maximums. Allez savoir…
Mais au fond, tout ceci n’avait que peu d’importance car Jean Batiste a illuminé toute l’après-midi. Certes le Garcigrande d’ouverture était-il imprésentable de tout (trapio et cornes) et sans tempérament. Mais, très en confiance, quieto, d’une grande intelligence, JB a inventé un toro, dans une faena allant a mas, très bien conduite et de grande variété (une oreille). Il a su mettre en valeur le La Quinta, un peu gras et les cornes outrageusement basses, en ordonnant à son piquero de se placer sous la présidence, et le trasteo d’Alberto Sandoval, merveilleux d’exécution, a fait le reste en deux rencontres. Christian Romero son péon historique et son ami, invité à la fête, la soixantaine approchant, a planté deux paires de banderilles devant un public conquis. Puis ce fut, après un brindis à ses enfants, un festival de bon goût, de relâchement (le vrai), d’enchaînements de perfection, et après un petit passage à vide à gauche, d’où s’est cependant détaché un somptueux molinete très bas, très swingué, une fin de faena par série de face sans épée rematée par un pecho plein de desmayo, le tout sur une zarzuela merveilleusement interprétée par notre mezzo (recibir, deux oreilles, vuelta au toro).
Sans doute tout ceci était—il agréable, un peu anodin, sucré. Mais il en fallait plus pour nous gâcher la fête. Alors quand on vit, avant la sortie du dernier, Juan Bautista attendre son heure, le dos à la barrière, on s’est mis à l’applaudir, avec reconnaissance pour ce qu’il avait souhaité nous offrir, pour la manière, cette classe de gendre parfait, cette retenue qui est sa marque et qui le distingue de tant de directeurs d‘arènes….A l’applaudir avec ferveur, interminablement, tout le public debout et lui au centre, lui nous saluant, avant de lever sa montera en croissant de lune vers le ciel, en hommage à son père. Des larmes ont coulé. Sur nos visages et sans doute sur le sien. Un péon, témoin de ce moment d’émotion, lui prendra la nuque comme on le fait entre hommes quand on craint de se caresser. Son toro sort, un Vergahermosa, de 530 kgs, pas bien mieux présenté que les précédents, accueilli par une passe de cape à genoux, et qui se révèle à la pique encasté et de grand jeu, y allant trois fois goulument, le piquero, très sûr, à la puerta des cuadrillas, un toro qui ne pousse pas et fuit aussitôt le châtiment mais qui revient avec une codicia énorme. Juan Bautista, pour ce dernier combat, partage le tercio de banderilles avec ses peones, plante une paire al violin de grand impact et brinde. La faena ? Un bonheur de faena devant un bonheur de toro, noble, de beaucoup de présence, de grand allant, inlassable, auquel Juan Bautista sait donner la distance et qu’il torée avec rythme, temple et ligazon. Soudain tout le monde se régale. Le public, le toro, et le torero surtout. Un moment d’une telle plénitude, de telle aisance, qu’on en a les larmes aux yeux, pour lui, pour nous, pour ce qu’on voit et pour ce qu’on devine. Le toro est si superbe et si bien mis en valeur par le maestro qu’on applaudit sa charge, son galop, sa caste. Juan Bautista, à cet instant s’oublie, atteint la plénitude des derniers instants. P… que ce doit être bon ! L’arène est, comme lui, sur un petit nuage. Le mouchoir orange tombe- celui-ci d’évidence- et Jean Batiste raccompagne son toro par luquesinas jusqu’au toril, attend qu’on referme la porte pour se retourner vers nous et on voit alors un immense tournesol glisser sur les mystères des chiqueros qui se referment. Ce point final d’une carrière est donc un soleil qui le raccompagne. Le symbole est saisissant.
Juan Bautista revient au centre du ruedo. La communion entre le torero et son public est fervente et elle dure de longues minutes, poignantes, comme si l’on regrettait de se quitter ainsi, si bellement, si sagement, si intelligemment. A l’heure exacte où le soleil se couche sans drame, au meilleur de l’horizon d’un homme.
C’est alors Ponce, et non un peon, qui s’approche, se baisse pour ramasser la montera en croissant de lune et la remettre au retrayant. Ce geste d’estime du vétéran qui ne parvient pas à quitter le ruedo à l’égard du choix de son cadet est superbe. Puis ce sera la vuelta du torero, accompagné du mayoral et de ses trois enfants, la petite fille en arlésienne et les deux garçons, plus jeunes, qui se disputent drôlement les bouquets de fleurs que le public jette au passage du maestro. Et toute cette petite famille qui salue encore au centre, les enfants regardant leur père pour savoir comme on doit lever le bras. C’est proprement irrésistible.
Il y manque encore quelqu’un : l’épouse. Mais la voilà qui prend place à côté de la banda et des chœurs pour entonner l’Hymne à l’amour accompagnée par l’orchestre Chicuelo de l’ami Rudy. Les deux toreros et leur cuadrilla écoutent religieusement, regroupés ensemble sur la piste non loin de la talanquera. Applaudissent à la fin puis sortent en triomphe. Rudy, qui sent toujours les choses, continue à jouer. Nous restons encore de longues minutes comme si l’on refusait de se séparer.
Il est vrai qu’une despedida, ce n’est pas seulement le choix ou le destin d’un homme. C’est pour nous tous, le temps qui passe et l’amertume de l’absence.