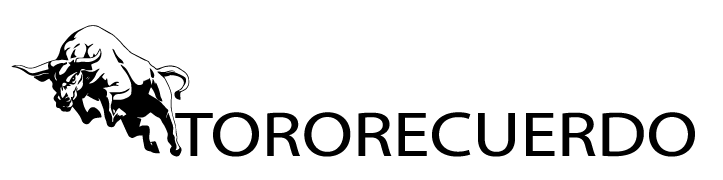Evidemment pour ceux qui n’avaient pas vu les Dolores Aguirre, la corrida a dû paraître muy entretenida. Les autres n’ont pu s’empêcher de faire la comparaison, en défaveur de l’élevage portugais. D’emblée en dépit de la présence de ces toros, de leur présentation et de leur caractère- n’hésitant pas à lutter contre les burladeros où ils ont à plusieurs reprises fiché la corne et on songeait aux dégâts possibles dans la chair…- on fut un brin déçu. Le premier, merveilleux de présentation et allant aux piques avec gaz (hélas piqué dans le dos, ou en arrière), a paru se vider de toute sa caste dès la première rencontre ; le deuxième fut changé pour un Penajara, qui fit un peu illusion sous les piques mais était en réalité décasté, le troisième, bon aux piques (il y en a eu quatre), fut un peu négligé par son torero et il fallut en réalité attendre la deuxième partie de la corrida pour s’électriser.
Sanchez Vara, invité à saluer après le paseo après son fait d’arme de l’année passée devant un élevage impossible et qui, lui, eut à l’esprit de partager l’hommage du public avec ses deux compagnons de cartel, fut un lidiador de perfection, un chef de lidia attentif, présent, efficace. Il accueillit le quatrième par larga de rodillas suivie d’un bouquet de véroniques très allurées. Beau tercio de piques, Navarette à la manoeuvre, citant de son cheval, précis d’exécution, des piques brèves et en place. Puis vint le tercio de banderilles, que le maestro pose lui-même, et que la cobla (la fanfare catalane) a véritablement enluminé, tenant la note, comme le fait un chanteur d’opéra, jusqu’à ce que le torero s’élance et vienne à juridiction ; alors la musique reprend dans des ébranlements de foule conquise par la variété et l’engagement du torero. Une deuxième paire de feu, une troisième, où Vara est debout sur l’estribo, les banderilles à la main, devisant gentiment avec un bonhomme dans le callejon, genre conversation de salon, avant de s’élancer vers son fauve pour un violin épatant de justesse et d’exposition de soi. Le gradin en redemande, la présidence laisse faire, et voilà la quatrième, al quiebro, qui fait se lever tout le monde. Dieu que c’est beau ! Faena sûre, sérieuse et émouvante avant que le toro ne baisse ; on sentait que Sanchez Vara avait fait l’essentiel par sa présence, sa hombria, ses banderilles.
Sergio Serrano, que je découvre, fut intéressant. Son premier ( le Penajara) ne permettait rien par faiblesse (tardo, ne bougeait pas, ne chargeait pas, bon…). Sur son second, il montra de beaux gestes, des derechazos main très basse, une passe du mépris vipérine et des naturelles muy pintureras, les épaules rejetées à l’arrière, la muleta somptueuse, mais qui manque de dominio, puis on sent que l’effort lui coûte, il parle à son toro comme pour l’apprivoiser ou se convaincre que tout n’est pas terminé. Une épée aléatoire et une pluie de descabellos gâchent beaucoup l’impression d’ensemble.
Mais c’est le sixième combat qui restera dans la rétine, après la dernière Santa Espina du cycle. Un toro énorme avec des cornes véritablement vertigineuses qui jettent l’effroi et qu’ici, évidemment, on applaudit à tout rompre ! Une réception à la véronique parfaite en dépit d’une corne gauche tueuse. Un tercio de piques que le président interrompt, comme par lassitude de ne plus voir ce toro charger quand on le cite interminablement, et un tercio de banderilles terrorisant, où le toro cherche constamment sa cible, de la tête et de ses cornes redoutables, qui sont partout, sur les burladeros quand il n’y a que ça, sur les hommes dès qu’ils bougent, sur le premier banderillero qui s’apprête, s’élance mais, ne pouvant aller plus loin face à la charge criminelle de son adversaire, jette les batons au sol pour survivre, poursuivi par le furieux animal jusqu’à la talanquera, où il a failli d’un cheveu être pris dans le dos, comme Montuliu à Séville. C’est la terreur dans le ruedo ; on en a le souffle coupé. Et c’est à cet instant que l’on voit le second banderillero, dans son joli costume vieux rose, s’élancer vers l’ennemi, et lui planter les banderilles en parvenant à passer entre les cornes, puis à feinter pour s’en dégager et courir se protéger en remerciant la Vierge Marie. Tout est inouï : avoir osé, s’être ainsi confronté à l’impossible, avoir cru au destin et aux miracles de la religion. Cet homme est un héros ou un Saint et il s’appelle Pedro Cebadera. Il croit sans doute aux miracles de la foi. L’arène est debout, commotionnée par ce qu’elle vient de voir, gorgée de l’hombria de ce péon inconnu, transfusée par la folie, le courage, l’hubris de ce torero dont elle entend récolter des miettes de gloire. Cependant rapidement oublieuse, on l’entend vaguement protester quand la présidence prend la sage décision de changer de tercio avant qu’il ne soit trop tard.
C’était donc le toro que devait affronter Damian Castano, un toro impossible, dangereux, brutal, terriblement armé : un os.
Et là encore, la corrida a pris sa vraie dimension, qui est l’héroïsme des hommes qui entendent se mesurer, avec une épée factice et un bout de tissu, à la sauvagerie des fauves. Et il fallait voir le Damian toréer à l’ancienne, par le bas, avec les jambes, puis, soudain exalté par le défi, un défi vital, hurler au ciel pour y puiser du courage, comme l’avait fait en silence, quelques minutes auparavant, son saint banderillero au péril de sa vie, pour servir son maestro et honorer son contrat. Une décision et une volonté mythologiques, l’Odyssée d’Ulysse et l’Illiade en même temps, un homme seul qui doit affronter le Cyclope et le vaincre. Le miracle eût lieu, et Castano parvint, à force de courage et d’abnégation, à tirer de cet adversaire qui n’avait d’autre instinct que de tuer, trois puis deux naturelles, insoupçonnées, incoyables d’exécution, dans le ventre de la muleta, autour de la jambe croisée, offerte en sacrifice. C’était Los Gigantes. Le temps était suspendu, arrêté, à chaque passe. Et une fois la passe achevée, on voyait la muleta y revenir à nouveau, et à nouveau embarquer les cornes, la tête, le corps de ce monstre. L’homme avait triomphé. Parce qu’il était resté devant et avait tenté l’impossible. Qui était advenu.
Faut-il que ces Cérétans, manifestement sensibles à ce qu’ils venaient de voir, soient sots, cruels et dépourvus de jugement pour, après avoir applaudi Castano à tout rompre après ce combat de feu, l’aient privé, par leurs protestations honteuses, de la vuelta de récompense à laquelle cet homme, dont la glorieuse prouesse avait fait notre après-midi, aurait dû attacher son souvenir et le nôtre. Celui de la puissance émotionnelle de notre passion commune, qu’ils savent pourtant si bien entretenir et dont ils sont quasiment le seul conservatoire. Comme qui attend le messie en récusant toujours son retour, en mégotant sur la parousie quand elle est là, par crainte de l’imposture. L’imposteur, ce jour à Céret, ce furent ces protestataires radicaux qui ont sans doute estimé que Castano était en dessous sans s’aviser qu’il avait été, pour sa part, devant.
Quel dommage… Avoir tant de critères pour si peu de jugement est tout de même un paradoxe. Céret est Céret. C’est ainsi…