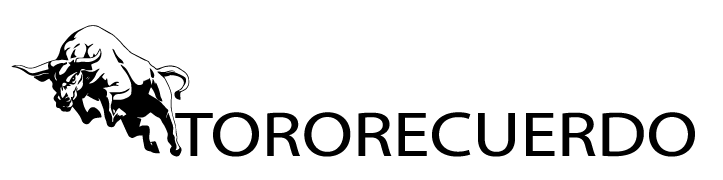Arles, 7 avril 2012, matin- Conchi Rios, Cayetano Ortiz, Fernando Adriano/ Antonio Palla
Des grappes de glycines en encensoir aux abords du théâtre antique : ça y est, la saison reprend, et aujourd’hui, ce sera novillada.
Danièle Sallenave citait, il y a quelques jours, lors de son discours de réception à l’Académie française, cette phrase de Samuel Johnson, un érudit anglais du XVIIIème, inventeur du dictionary (le Littré Grand Breton en quelque sorte) : « Une femme qui écrit est comme un chien qui danse ; ce n’est pas qu’il le fait bien mais on s’étonne de le lui voir faire ».
Eh bien Conchi Rios, c’est un peu la même chose, qui torée avec un ruban bleu turquoise dans les cheveux et crie « hei » « hei » en direction du toro, les jambes écartées. Quel drôle de spectacle ! Evidemment on ne moufte pas, et on applaudit même avec chaleur ; la détermination –en a –t-il fallu pour se retrouver ici et avoir convaincu ses compagnons de cartel, les directeurs de plazas et les éleveurs de toros de lui faire une place dans ce monde d’hommes- ; le courage ncontestablement ; le talent pourquoi pas ? – on évoque une sortie en triomphe par la Puerta Grande à Madrid. Oui, on applaudit et il ne viendrait à personne l’idée d’avouer que ce spectacle est insolite, et laid surtout, très laid, de cette jeune fille (21 ans) qui mime les hommes jouant les toreros face à une bête fauve. Alors, on fait semblant, et on prend des photos comme d’un monstre de foire ou d’un enfant à trois têtes. Un agrandissement dans le salon, comme une mauvaise repro de Bottero.
Les Palla sont bien sortis ; ils poussent à la pique, soulèvent même la cavalerie jusqu’à la renverser par deux fois, et donnent du jeu, le lot d’Adrian surtout.
Conchi est appliquée, consciencieuse, raide, sans imagination, et ne sait ni citer ni peser sur son toro. On sent cependant un très fort mental, qui ne sert pas à grand-chose compte-tenu du peu de qualités à servir. Grande tueuse, puisqu’il faut tout mettre au féminin….
Cayetano Ortis a un joli prénom, vieux, désuet, un peu comme chez nous Gaston ou Alphonse. Un prénom que seules des lignées hors du monde savent entretenir, un prénom de vieilles familles repliées sur leurs secrets, nobles ruinés ou paysans d’un autre âge. Et ce prénom, le jeune biterrois l’a choisi pour apodo, puisqu’il est français comme vous et moi. Sympa ! Mais ce Cayetano-ci est lointain et marginal avec le tissu. Il arrache deux séries de naturelles à son premier, appliquées et d’un joli tracé ; depuis le gradin on l’entend respirer comme un toro à chaque troisième temps de la passe. Pour le reste, un festival d’enganchones et un ennui mortel sur son second.
Fernando Adrian, sérieux comme un jour sans pain, est élégant, d’attitude et de geste. Il a le temple sec d’Extremadura (un peu comme Manolo Sanchez de Valliadolid), une belle allonge et un joli poignet, mais le tout sans art ni frémissement intérieur. Il se sert bien de la cape et exprime une jolie variété à la muleta, passe de las flores, firma, cambio en cours de séries, joli pecho de ceinture : il est grand de taille, en tire profit, et quand il aguante le toro dans une porfia finale, il ne la rend pas interminable ; c’est bien. On le dit prêt pour l’alternative en fin de saison.
Mais pourquoi donc, ces jeunes gens expriment-ils si peu d’enthousiasme à se trouver là, dans un rêve d’arène de deux mille ans d’âge, face à un public bienveillant, sous un grand soleil, à quelques heures de la Résurrection ? L’époque décidément est à la déprime.
Arles, 7 avril 2012, après-midi- Ruiz Miguel, Victor Mendez, El Fundi/ Conde de Mayalde
Voilà un drôle de cartel, aux tons de mélancolie. El Fundi se retire, et cette saison de despedida va lui assurer bien des contrats qui, sans elle, n’auraient peut-être pas été offerts en si grand nombre. Pour lui rendre hommage, on est allé chercher deux toreros auprès desquels il faisait naguère le paseo, retirés des circuits depuis près de 15 ans. Le Grand Ruiz Miguel, 62 ans et « notre pote » Victor Mendez, 53 ans. Des braises de gloires en guise de cartel.
El Fundi est un torero de petite taille qui affronte des monstres. Le contraste est saisissant et lui a assuré un succès durable parmi les toristas qui aiment les élevages difficiles et les fauves retors qu’il faut combattre sans trop se dandiner. Une telle abnégation et le segment du marché taurin où ses qualités l’ont confiné imposent l’estime et le respect. Sauf à Madrid où l’on aime aussi le talent et le dépassement de soi. Les contrats se sont faits plus rares et le toreo du Fundi est devenu plus mécanique, sans âme. Vingt cinq ans plus tard, il fallait en terminer. On lui fera sans doute une statue à Céret, Vic-Fezensac ou Alès. Ici on lui offre une belle fête : « la Reine d’Arles » et « l’Ambassadrice du Riz », en tenues traditionnelles, traversent l’arène pour lui taper la bise, suivies par les élèves de l’Ecole taurine, qui doivent rêver de Castella ou de Manzanares mais qu’on a dû instruire du Fundi, et qui, pour l’heure, se présentent cassés en deux, sous le poids d’une selle camarguaise couverte de fleurs et autres présents qu’on offre au torero. Le maire est là qui rejoint la troupe en courant, un peu en retard. Et un speaker dit un mot plein de gratitude et d’affection pour le torero qui est aux anges : 24 corridas à Arles, la première en 89 avec des Yonnet -l’élevage local-, première Miurada en
1990 ; 27 oreilles coupées, 8 grandes portes. Cette cérémonie pour un torero estimable mais de second ordre – même dans sa catégorie- met un peu mal à l’aise. Badigeonner Fundi d’autant de compliments devant un Ruiz Miguel, que l’on a ressorti pour l’occasion et dont on ne dit rien, a quelque chose d’étrange. Mais bon, cela avait tout de même certaine allure.
Ruiz Miguel, dans un bel habit Christ du Grand Poder, a le cheveu blanchi des peones ; Mendez, lui, n’a pas changé : il se remet les couilles en place à travers son habit de lumières avec la vigueur d’antan.
Les toros, de 520 à 570 kilos, sont beaux, une robe à dominante castano, genre sombre humus de forêt d’automne, beaucoup de trapio et de belles cornes. Le quatrième, le plus beau de tous, devra hélas être changé pour boiterie, et le Palla qui sort en remplacement paraît insignifiant. Beaucoup de gueules longtemps fermées mais des signes de faiblesse, et une charge dépourvue de caste ; dispersée, courte, un peu brutale.
Ruiz Miguel entre en piste. Il a l’allure de ces vieux paysans qui, assis sur un banc au soleil, racontent sans se lasser à qui veut les entendre une vie de labeur, et les coups du sort dont ils ont triomphé. Facétieux, et riant quelquefois aux éclats, ils ne retiennent de ces longues peines, sûrs de leur sagesse, que la joie d’être encore là. Qu’on les écoute encore les rend un peu cabotins mais ils savent que chacun y trouve son compte.
Le corps entretenu et sec, la taille encore souple -et Dieu sait s’il en est fier ; à la moindre occasion, il saute dans le callejon par dessus la talanquera avec la grâce
d’un jeune homme, ravi de sa prouesse. Mais les articulations, «c’est pas ça ». En piste, il trottine, un peu hors sol : on croirait Michel Bouquet à l’Atelier, allant à pas menus, si léger qu’on le croirait en apesanteur, versant son talent comme une grâce, d’un peu plus haut qu’il ne faudrait, dans une assomption suspendue vingt-cinq centimètres au-dessus des planches.
Les ans délestent les corps, alors il y a le reste et ce reste, ici, est d’un seigneur : une économie de gestes souveraine ; un emplacement à mi-distance et de trois quarts
face au toro qui fait de la scène une épure ; une muleta planchada qui aimante aussitôt l’adversaire et le tient à sa main sur un parcours bref et sans scorie. Une sûreté du bras inouïe. Tout est naturel et limpide. Et tout est toréé au maximum. Bien sûr, souvent le troisième temps de la passe est escamoté et le torero contraint de rompre pour se replacer. Mais, c’est pour mieux reprendre en nous servant à nouveau l’eau pure de son toreo, qui nous rappelle aujourd’hui le vieil Antonete. Quelle science et quelle leçon !
D’abord devant un toro qui marque divers signes de faiblesse. La faena est à mi-hauteur, ce qui rend le jeu plus transparent encore, mais on goûte, à la fin, des muletazos qui se dérobent et des passes de la firma, le bâton tenu à la verticale, d’une beauté sauvage. Puis, devant un Palla de remplacement, deux largas d’une toreria à faire hurler et, à la faena, une série de naturelles certes un peu lointaines mais au dessiné parfait, des passes de ceinture, et soudain cet émoi si reconnaissable dans une arène quand on sent, unanime, qu’il se passe quelque chose. Alors Don Ruiz rajeunit de vingt ans, et sert des passes du cambio comme un jeune homme, puis des naturelles qui n’ont jamais si bien porté leur nom, avant de terminer dans les cornes, tremendiste en diable, dans une tauromachie faustienne pleine d’une énergie neuve. Pinchazo, entière concluante. Le vieux torero saute de joie, le poing levé, en proie aux émotions intimes -rarement discrètes- que provoquent les manifestations inattendues d’un regain de jeunesse. Nous lui faisons fête, il rit, se régale de son triomphe, prend une poignée de sable du ruedo qu’il porte près du cœur, renvoie les éventails et les pull que dans l’enthousiasme le public lui lance, s’empare d’une gourde à la volée et boit à l’espagnole, la tête renversée, le goulot maintenu à distance. Le jet d’alcool est interminable sous les vivas du public : l’élixir de jouvence n’a pas de fin.
On sent Victor Mendez moins sûr, et il faudra sans doute attendre qu’il vieillisse encore loin des ruedos pour atteindre à cette essence.
El Fundi regular et sans charme.
A la fin de la course, on porte Ruiz Miguel en triomphe. Foin des conventions ! il est juché sur les épaules de Medhi Savalli, le jeune maestro arlésien qui torée le lendemain.
Arles, le 9 avril 2012- Ivan Fandino, David Mora, Thomas Dufau/ Fuente Ymbro
L’aficion a los toros est une sagesse -une discipline ?- de l’attente. Mais la passion la déborde constamment, cela fait son charme. D’où ces surprises que l’on surcote aussitôt, tant l’attente nous épuise. Ivan Fandino et David Mora sont les surprises de 2011 ; méconnus, sérieux, affrontant des élevages réputés difficiles, délaissés par nos muscadins du G10, du courage et un bagage technique qui a surpris. Avec cela, assez jolis garçons, chacun dans son genre. David Mora, à l’élégance froide d’un Dominguin ; Ivan Fandino, gueule gitane et profil d’empereur, buste de matamore qu’on imagine de bronze. Le casting avait un air de brise fraîche. Et on aspirait au changement. Nous avions trouvé nos Mélenchon, les anti-systèmes modérés, alors comme dans une élection où l’on s’ennuie, les sondages ont grimpé, et se sont nourris d’eux-mêmes : Mora et Fandino ont aussitôt été portés au plus haut. Plus haut que leur cartel.
La drôle de corrida de Fuente Ymbro les a remis à leur juste place. Corrida décevante, certes ! Des toros en cornes et même très en cornes, mais légers et les trois premiers très faibles, plus qu’économisés à la pique et qui s’affalent lamentablement. Mais les trois suivants tenaient sur leur pattes, donnaient de la corne, se retournaient comme des chats, incommodes mais à toréer.
David Mora ne l’a pas fait. Il a voulu servir une faena standard là où il fallait rectifier les défauts de son adversaire. Dans un silence consterné, on entendait seulement sa cuadrilla l’encourager depuis le callejon. A aucun moment il n’a pesé sur son toro, brave et encasté, à aucun moment il ne l’a dominé. Bajonazo et, à mon humble avis, gros échec de début de saison.
Ivan Fandino a davantage convaincu. Devant le faible Palla sorti en premier, en remplacement de l’invalide qu’on a dû puntiller en piste après le tercio de banderilles, six ou sept passes hautes, les pieds joints, sans bouger, puis des pechos templés et toréés, et deux séries de naturelles d’où se détachent une passe merveilleuse, dans chacune, hélas au milieu d’engachones. Sa deuxième faena devant un Fuente Ymbro conséquent ne fut pas sans mérite, avec une série parfaite de la gauche et un tres en uno avec changement de main, naturelle et pecho plein de toreria. 2/3 d’épée, une oreille méritée qui s’ajoute au trophée précédent qui l’était moins.
Thomas Dufau a su tirer (un peu) profit de la bonté de son premier adversaire, très faible. Compas ouvert, il tire des passes, mande beaucoup, à droite, à gauche, à l’endroit, à l’envers. Cela manque d’imagination et de ferveur mais la débilité de son adversaire ne permettait peut-être pas grand chose d’autre. Très vert en
revanche sur le dernier, se fait bousculer, manger le terrain, se trouve en échec complet à gauche. On ne torée pas tous les jours des toros choisis pour José Tomas…
On sort d’un tel après-midi un peu déçu d’avoir été déniaisés, de toros et de toreros.