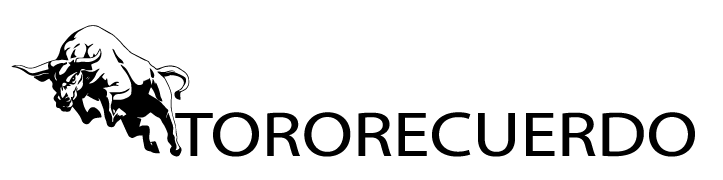On ne demande à un torero ni d’écrire ni de parler, voilà pourquoi je me tiens généralement à distance des interviews de toreros et autres livres rewrités qui m’ennuient et apportent peu de choses à l’aficionado. Mais un ami qui aime lire et écrire, ce cher L A, nous conseille ce « Joselito »-là. Alors, je fais exception et, venant de terminer le livre, j’en sors tout chamboulé. Comme d’une grande corrida, de celles qui exaltent les émotions sans qu’on sache aussitôt dire pourquoi mais qui nous font lever de nos gradins et crier comme des gosses « To-re-ro, to-re-ro », le cœur brisé par l’émotion et les yeux pleins de larmes.
Fils de la misère né à Madrid dans les dernières années du franquisme ( le 1er mai 69), abandonné à l’âge de trois ans par sa mère qu’il ne reverra plus sauf au temps de ses triomphes, orphelin de son père quelques années plus tard, celui-là un marlou reconverti dans le trafic de drogue, quasiment enfant des rues, copain de zonards et lui-même petit voyou, le jeune José sera sauvé par la discipline de fer de l’Ecole Taurine de Madrid et l’affection de son directeur Antonio Martin Arranz qui finira par l’adopter et deviendra son apoderado. Ses frasques avec ses potes Fundi et El Bote, l’admiration pour l’aîné Yiyo – cependant « jamais à court d’une crasse », les premières becerradas, les bottines offertes par les putes du quartier, la concurrence entre camarades, les combats dédiés « aux richards du coin » qui sauront « faire un geste », il y a dans le récit de ces premiers pas dans le « droit chemin », une sincérité bouleversante tant Joselito évite d’opposer l’arène à la ville, cette vie d’apprenti torero à celle de fils de voyou, l’affection de son père biologique, irresponsable et dispersée, à celle de son père choisi, raide et réfléchie. Une sincérité sans concession ni pleurnicherie sur ce passé, sans blâme à l’égard de quiconque – à l’exception de sa mère et de ses oncles qui l’ont proprement abandonné au décès de son père- et un souci de tout dire au plus juste de la fidélité aux souvenirs et aux émotions d’alors, sans gloriole et moins encore apitoiement sur soi. Le portait qu’il dresse de Pepita, la compagne de son père qui a continué à s’occuper de lui ( « mon garde-fou, mon refuge » écrit-il malgré tout) est d’une grande justesse. Le récit de son mariage dans un Mac Do pour échapper aux paparazzi un moment d’anthologie.
Ce ton singulier fait le livre et la sincérité, le naturel du récit de sa carrière, sans bravade ni fausse-modestie, font songer à son toreo un peu altier et de grande tenue, restituent l’allure crâne du torero dans l’arène les jours avec et rappellent son visage fermé les jours sans. Il raconte ainsi sans rougir qu’il « remplissait l’arène » de sa présence, qu’il « avait un vrai pouvoir d’attraction sur les gens », confie de ne pas concevoir toréer en blue-jeans et baskets « même chez moi, en privé », être attaché à la solennité du toreo, porter des costumes de lumières qui faisaient la différence avec ceux des autres. Mais il confesse également que gamin « cador du quartier, j’étais torero et je ne me prenais pas pour une merde », reconnaît que des trois amis de l’Ecole taurine « Fundi était le plus artiste » et qu’il était alors, lui Joselito, « incapable de les surpasser », « timide et froid en piste », que ce n’était « pas alors la superclasse », puis encore après les premiers triomphes madrilènes et la première blessure- gravissime, le cou déchiré, le 15 mai 87- « Je n’aimais pas ce que j’étais en train de faire, la façon dont je m’exprimais devant le taureau », évoque une « saison pitoyable » en 89 après un triomphe à Madrid le 1er juin, « un bide de proportions bibliques » à Bogota , le scepticisme de Séville à son égard, qui le surnommera «Pepito » jusqu’à sa sortie par la Porte du Prince en 97, sa saison 98 où il « n’était bon ni à la muleta ni à l’épée ». Et à aucun moment nous n’avons l’impression que José joue avec le lecteur en forçant le trait de la présomption ou de l’autodénigrement.
Il raconte avec cette même intégrité sans calcul apparent l’envers du décor du mundillo, la peoplisation à laquelle il s’est lui-même prêté un temps, la puissance des grandes empresas, la presse mexicaine qu’on paie en attente de papiers flatteurs, les critiques taurins prêts à se compromettre, la pression des aficionados, les enjeux de la corrida télévisée, les rapports de force, y compris entre camarades de combat. Les annotations à cet égard sont souvent savoureuses, quelquefois un peu sèches mais jamais vachardes, tant on les sent, non pas impartiales mais sincères, Joselito ne dissimulant rien de son immense orgueil, autre nom de l’exigence, ni de ses petitesses ou de ses évitements (il n’a jamais combattu de Miura, n’a toréé qu’une fois à Pampelune).
Tout cela ferait déjà un livre fort précieux, mais s’y ajoute tant de profondeur et d’intelligence (sur le sens du toreo, la difficulté de l’épée, la peur et les blessures, les lassitudes, le cartel qu’on voit baisser, la dépression après la retirada, le crâne que l’on se rase pour être sûr de ne pas y revenir, la difficulté d’être apoderado (de César Jimenez), la frustration de l’éleveur de s’apercevoir, non sans douleur secrète, que cette appartenance au mundillo n’a rien à voir, mais alors rien du tout, avec l’addiction à l’habit de lumières, l’évolution de la corrida et les objections nouvelles qu’elle suscite) , que l’on en sort, oui, un peu hébété, comme d’une faena inspirée. Gorgée d’hombria. Etourdi de bonheur, pétri de reconnaissance mais affreusement tourmenté à l’idée que ce dont nous avons été les témoins soit déjà de l’histoire.
Pour se consoler, avant d’aller communier à Istres ( « Pour le dire sans détour, je n’ai pas les couilles, à cette heure, pour recommencer à jouer ma vie. Je le reconnais »p. 259), revoir sur Youtube le tercio de quites entre Joselito et Ponce à la San Isidro 96 où Francisco Rivera Ordonnez est méchamment tenu à distance pendant que Joselito, superbe et rayonnant, éblouit Les Ventas.